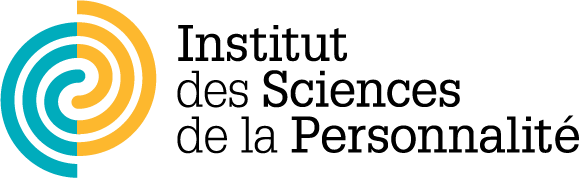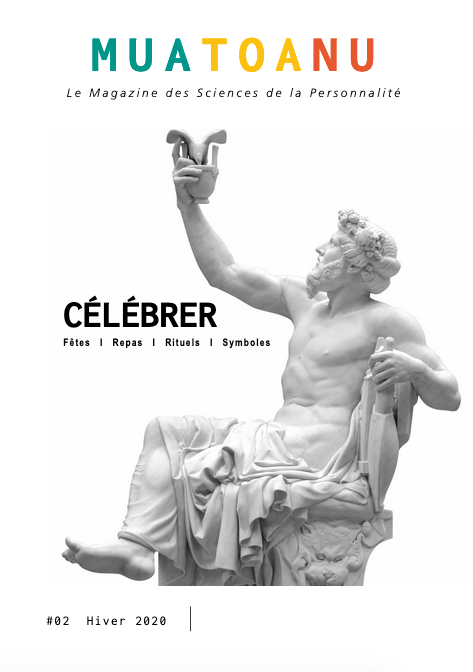Publié le
Journaliste et consultante éditoriale depuis 15 ans, passionnée par toutes les questions autour de la fin de vie et de la mort, Sarah Dumont a décidé en 2018 de fonder Happy End, site consacré à la mort et au deuil, pour aborder tous ces sujets sans tabou.
Happy End est un site indépendant d’information et de réflexion, proposant de nombreuses ressources pour envisager la mort et le deuil de manière apaisée : livres, articles, réunions, podcasts, témoignages ou entretiens.
Entretien réalisé par Marie-Noëlle Borel.
Comment t’est venue l’idée de fonder Happy End ?
Je suis journaliste à la base, et j’ai toujours eu une appétence pour les sujets de société, de psychologie, les sujets lourds ! C’était vraiment mon dada, à Femme Actuelle notamment.
Par exemple, quand je proposais un sujet sur les femmes battues, ou la pédophilie, on me répondait « on te le laisse volontiers, parce que nous, ça nous déprime totalement. »
J’ai toujours eu cet intérêt pour des parcours de vie difficiles, ou accidentés. J’ai aussi toujours eu une attirance pour le sujet de la mort. En 2010 a eu lieu le premier Salon de la Mort à Paris, et j’y étais ! Un très beau salon, au Carrousel du Louvre…. Pour aller y passer un week-end, c’est vraiment que le sujet me passionnait (rires).
Et puis j’ai passé 15 ans dans la même entreprise, un groupe de presse. J’étais bien dans ce que je faisais, mais j’avais toujours l’envie de développer des projets en parallèle. J’ai hésité longtemps, et puis mon corps a fini par parler pour moi, il fallait que je me lance…
La mort de mon père a aussi été un déclencheur. Quelque chose s’est passé après son enterrement : on a pu faire les choses, comme on l’entendait, et pas forcément comme la norme l’impose. Avoir eu le sentiment de respecter ce qu’il était à ce moment m’a apaisée, et aidée dans mon deuil. Cela m’a donné envie de dire à d’autres : « C’est possible, écoutez-vous dans cette étape cruciale ! Et cela vous aidera plus tard. »
Au début, je voulais monter une boîte de Funeral Planner, créer l’événement ultime, celui qui célèbre la mort. J’ai suivi et obtenu un DU sur le deuil en 2016, et entre-temps j’ai écrit un livre. Puis je me suis dit « tu aimes trop écrire, tu ne peux pas être juste commerciale et vendre des cercueils ! »
Alors j’ai transformé mon idée première en un media, un site d’information. Et Happy End est né en avril 2018.
L’objectif était d’abord de donner des infos sur tous les aspects pratiques d’une cérémonie laïque réussie et personnalisée. Puis élargir aux autres sujets : la fin de vie, la mort, tout ce qui est invisible… c’est aujourd’hui un site plus global, qui traite de la mort : avant, pendant et après.
C’est important pour moi de parler de la mort, et pas de la fin de vie : ce sont des moments tabous dont personne n’a envie de parler, ou de s’occuper. Ou alors les medias s’en emparent à la Toussaint, et ça s’arrête là.
Moi je voulais explorer ces tabous, et si possible de manière positive !
“La mort nous est devenue étrangère“
Comment “gérer” la mort de façon positive dans notre société ?
On n’est pas obligés de la vivre de façon positive, mais déjà : comment vivre en paix avec la mort ? Comment ne plus se laisser déposséder de ce moment, qui est justement un moment de vie ?
Quel regard portes-tu sur l’évolution des célébrations et rituels liés à la mort, dans nos sociétés ? Comment notre humanité s’est-elle laissée déposséder de cette dernière partie de la vie, et donc de la mort ?
Je vois d’abord le déclin progressif de la pratique religieuse : on avait son référent, ses rituels… et on s’en éloigne.
Et puis les progrès médicaux : aujourd’hui la mort n’est envisagée que dans la sphère médico-sociale. Elle n’est plus dans l’ordre de l’intime ; elle est balancée chaque jour à la télé et dans les médias. La mort est devenue presque un sujet de spectacle.
La mort est en quelque sorte externalisée ?
Bien sûr ! Dès qu’on va trop mal, on est hospitalisé, on ne meurt plus chez soi. La mort nous est devenue tellement étrangère qu’on en a de plus en plus peur.
On ne porte plus le deuil, on n’organise plus de veillée, ni de cortège funèbre. Or, ces temps avaient une fonction : ils étaient un espace pour vivre et exprimer le départ de quelqu’un, avec ses conséquences sur notre vie. Les rituels autour du deuil permettaient d’être en relation avec nos morts, de matérialiser la séparation, et surtout d’être accompagnés.
La disparition de ces rituels fait que la mort nous échappe.
Faut-il aussi masquer les émotions négatives ?
Oui, notre société prône une culture de performance. Quelle que soit l’épreuve, on doit se relever le plus vite possible. D’ailleurs, le marché du coaching explose. On n’ose plus dire à ses proches qu’on va mal : on se tourne vers des professionnels.

“Solitude des endeuillés”
Avec parfois pas mal d’injonctions autour de la pensée positive, voire d’une obligation à la résilience, justement…
En effet, la plupart des endeuillés confient qu’ils ne se sentent pas le droit d’exprimer leur fragilité. Certains n’ont jamais pu parler de leurs morts, d’autres ont reçu de leur entourage des remarques tellement maladroites – ou stéréotypées – qu’ils ont décidé de ne plus aborder le sujet.
Cela illustre le malaise général qui entoure le sujet de la mort. “Je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas ce qu’il faut dire, je n’ai pas l’habitude.”
En résumé, deux évolutions sociétales renforcent le sentiment de solitude des endeuillés : l’externalisation de la mort, et la suppression des émotions négatives.
Quelles sont les réactions fréquentes que tu observes chez les endeuillés ?
Happy End organise des Apéros de la mort !
Derrière ce titre un peu provocateur, l’idée était de réunir toute personne souhaitant parler de la mort dans un lieu public. Bien sûr, on a beaucoup de personnes endeuillées qui viennent, mais pas seulement.
En premier lieu, elles expriment un sentiment de solitude : « Je n’ai pas eu la possibilité de m’exprimer, de parler de mon chagrin ».
Elles font aussi part de l’incompréhension des proches, voire des très proches. Et donc de leur joie de pouvoir de venir en parler avec des inconnus qui vivent ou qui ont vécu la même chose.
Les Apéros de la mort ne sont pas pour autant un groupe de parole ; c’est un événement qui peut rester ponctuel ou isolé, pas un cycle. Et bien évidemment ça ne remplace pas un accompagnement professionnel, à visée thérapeutique. L’idée c’est juste de se faire du bien, modestement, sans autre prétention.
On m’écrit souvent pour me dire « Merci de parler de la mort avec un esprit positif, ou en tous cas différent. »
Des parents qui ont perdu leur enfant viennent aussi : le fait de pouvoir parler ouvertement de leur sentiment, ça contribue à alléger un tout petit peu cette chape de plomb qui pèse sur les endeuillés.
Parfois, certains ont beaucoup avancé ; c’est essentiel de pouvoir partager avec l’entourage qu’il y a une vie après.
“Souvent, parler d’une mort n’a pas été possible”
Ces Apéros de la mort sont-ils adaptés pour des personnes qui viennent de perdre un proche et qui sont dans la phase la plus vive de leur deuil ?
Non, je ne pense pas. Au début, l’endeuillé qui vient de perdre un proche – et qui en souffre – a plutôt besoin d’un soutien individuel de la part d’un professionnel ou d’une association. C’est une question d’espace : à 15 ou 25 personnes, un endeuillé très récent n’aura probablement pas la place suffisante pour exprimer son chagrin. Il faut donc un autre format d’écoute individuelle et thérapeutique avec un professionnel.
Parmi les gens qui viennent, je vois aussi des personnes âgées qui se confrontent à leur mort prochaine : je pense à une dame de 75 ans, très à l’aise avec l’idée de la mort, qui avait déjà tout prévu, mais dont les enfants ne voulaient rien entendre !
Ces soirées sont aussi l’occasion de parler de nos morts quand ça n’a pas été possible au sein de la famille – que ce soit un suicide, un accident, ou toute autre tragédie dont on a préféré ne pas parler, et devenue un tabou.
C’est une manière de recréer les communautés disparues. Et aussi de célébrer, au sens étymologique du terme : marquer un rite de passage, nommer, reconnaître, dire… et pas seul(e).
Exactement ! Et heureusement il n’est jamais trop tard pour « faire sortir » (ou mettre à l’extérieur) le poids d’une tragédie, parfois même 60 ans après… J’ai ainsi le souvenir d’un monsieur de 80 ans qui a pu enfin parler de son jeune frère qui s’était suicidé. Il en avait même fait un livre, à la fois pour lui rendre hommage et pour « célébrer » son passage. C’est très émouvant.

Est ce que les endeuillés vivent parfois, via le regard des autres, ce que je vais appeler un peu brutalement une forme de hiérarchie du deuil ? Perdre un enfant, c’est “une tragédie dont on ne se remet jamais“, perdre ses vieux parents, c’est “dans l’ordre des choses“, perdre son animal de compagnie c’est un non-sujet, qui peut susciter une forme d’ironie… alors qu’on sait très bien en psychologie que la souffrance se fout des segmentations.
Oui, c’est très fort, c’est un mécanisme de projection qui joue à plein : on projette sur les endeuillés notre propre ressenti, ou notre vision, ce qui est l’inverse exact de l’empathie.
Le deuil animalier est très tabou, et très peu de gens s’autorisent à l’exprimer, tant ils ont peur des moqueries.
Dans ce que j’entends, dans les témoignages des endeuillés, je dirais que la perte d’un bébé semble être le tabou le plus fort, ou en tous cas celui qui isole le plus.
Et cela, encore plus spécifiquement dans les situations d’IVG, ou d’enfant mort-né : à partir du moment où l’enfant n’est pas sorti de l’hôpital ou de la maternité, il est un inconnu social pour les autres.
La communauté des «MamAnges » ou des « ParAnges », comme ils se nomment, est d’autant plus forte et soudée qu’ils sont confrontés à un deuil qui n’est pas reconnu.
C’est vital pour eux de pouvoir donner une existence à cet enfant, parfois juste de prononcer son prénom.
Et – j’imagine – ajoutons à ces injonctions sociales, le fait que tout le monde ne va pas au même rythme dans un processus de deuil : il y a des mécanismes inconscients de personnalité individuelle, le poids de l’histoire familiale vécu différemment…
C’est en effet très visible dans les fratries, et ça contribue à ce sentiment d’isolement, vécu paradoxalement auprès des plus proches, car ils vivent aussi le deuil – mais pas du tout de la même façon.
Quels sont les tabous les plus tenaces ?
Le suicide, je pense… parce qu’en plus de l’interdit social et religieux, vient s’ajouter l’immense culpabilité des parents et des proches, qui n’ont pas pu l’éviter.
Mais il y a aussi l’euthanasie et la mort assistée : ce sont des sujets qui déclenchent des phénomènes très violents de rejet… ou d’adhésion.
On est là sur un phénomène d’identification : c’est comme si ce choix individuel risquait de – ou pouvait – devenir une norme sociale. On préfère ne rien savoir, et que ce choix soit dissimulé.
C’est peut-être parce qu’on touche à la valeur de vie ? Dans notre travail à l’Institut, en formation ou en recherche, on voit bien quand des valeurs profondes sont touchées : il n’y a plus de rationalité dans la réaction, ni de mesure dans le discours…
Et heureusement que les associations sont là, pour jouer ce rôle de régulation ! Face à une société qui a peur des changements collectifs, il faut des espaces plus resserrés, où l’on peut échanger avec ses « pairs », et explorer des choix individuels, pour les accompagner émotionnellement.
C’est aussi l’endroit où l’on va s’entraider ; ceux qui ont fait ce chemin vont pouvoir transmettre à d’autres le récit de leur expérience. On a tous vécu la même chose, certes on ne va pas tous au même rythme, et certains sont plus avancés que nous. Alors ils nous amènent une forme de perspective, en attendant l’apaisement.
“Le deuil transforme, c’est un chemin d’existence”
On retrouve ici le rôle de la célébration : on reconstitue ce qui manque, un espace de cheminement psychologique, émotionnel, psychique et spirituel.
Parlons de spiritualité au sens large, ce qui dépasse la religion. Faire appel à un chaman ou à un medium – j’en entends parler de plus en plus – c’est aussi toucher la conscience de quelque chose qui dépasse notre passage terrestre, et qui lui donne un sens.
On sait aussi que le deuil est souvent un événement déclencheur d’une transformation, ou l’accélération d’un processus d’individuation : on devient plus réceptif à la spiritualité, à la part d’intuition et d’inconscient collectif qui fait partie de notre humanité depuis la nuit des temps.
C’est dans le chagrin que les barrières tombent… peut-être par réflexe de survie justement. Je n’ai probablement pas d’autre choix que de m’ouvrir à ce qui me dépasse, à ce que je n’ai pas pu maîtriser ou contrôler. La mort est aussi une manière de découvrir une autre forme de célébration de la vie.
Le deuil transforme. C’est un chemin pour aller à l’essentiel, là où on doit être. En tous cas, c’est souvent comme ça que l’expérience est décrite par ceux qui ont fait ce chemin. Et ça mérite d’être entendu, et même écouté.
Je constate aussi que cette volonté de se réapproprier la mort émerge de plus en plus chez les nouvelles générations, qui sont peut-être plus à l’aise avec l’expression de leurs émotions, ou qui en ont moins peur. Mais elles font face à une grande majorité de gens qui ne veulent pas en entendre parler.

Ce qui fait totalement écho au schéma actuel de transition de notre société ! On a d’une part une société individualiste qui contrôle la performance en externalisant ou en supprimant les émotions négatives, et d’autre part une société émergente, plus reliée et relationnelle, plus humaniste et acceptante des émotions… Mais ces deux mondes ont beaucoup de mal à se parler aujourd’hui !
C’est intéressant à ce titre de regarder la manière dont les pratiques autour du deuil évoluent dans d’autres pays, notamment les pays anglo-saxons, Canada, USA…
La mort y est vécue avec moins d’austérité et de mise à distance : dans certains cas, c’est un véritable « événement ultime », qui est entièrement personnalisé. Certaines personnes organisent même une fête d’adieu du vivant !
On a d’autres gestes, d’autres symboles : par exemple un mandala floral auquel chacun va contribuer, et que l’endeuillé va pouvoir emporter. Au lieu de faire livrer une couronne (on reste ainsi à distance !), on construit ensemble une oeuvre d’art éphémère, ce qui devient un geste réparateur et collectif… On réinvente un rituel.
La notion d’action est aussi importante dans ce processus de réappropriation : 75% des endeuillés déclarent que participer activement à l’organisation des funérailles a eu un effet d’apaisement sur leur chagrin.
Aujourd’hui, c’est un tout petit marché, mais qui suscite beaucoup de curiosité et d’intérêt, y compris chez les professionnels du funéraire : comment réinventer le rite de passage qu’on n’a plus ?
Je trouve passionnante l’idée de personnaliser ses funérailles, et donc quelque part de célébrer l’identité de la personne qui nous quitte.
Ça va même plus loin, je pense. Avec le développement des contrats obsèques, on décide en amont de ce qu’on choisit de transmettre.
Nos parents nous disaient « tu feras bien ce que tu veux, et je m’en fous, puisque je ne serai plus là », mais les nouvelles générations ont envie de choisir… jusqu’au bout.
L’enjeu sera quand même de laisser un peu de place à ceux qui restent, mais c’est un autre sujet ! (rires)
Tout comme on célèbre une naissance, on devrait pouvoir célébrer une personne qui nous quitte, et l’impact qu’elle a eu sur nos vies, même si sa vie a été courte, ou même si elle n’est pas née.
Or, on ne s’autorise plus à célébrer nos morts, sauf à la Toussaint ! On serait des millions à aller sur les tombes à ce moment-là, mais quid le reste du temps ? Où sont nos morts, leur mémoire et leur impact ?
Imaginons que j’aie envie d’organiser un dîner en hommage à mon père décédé il y a des années : on me regarderait avec des grands yeux…
J’ai aussi l’exemple d’une mère qui a perdu son fils d’un an (une leucémie), et qui a choisi, l’année suivante, d’organiser un week-end avec sa famille et ses amis : c’était une célébration collective où chacun a pu parler de l’absent, pour le rendre présent, mais aussi pour dire comment ce départ avait changé sa propre vie.
Dans tous les cas, ça va encore prendre du temps – peut-être une ou deux générations ? Mais ça me plaît de penser que – même si parfois ça choque un peu – j’aurai pu contribuer à amplifier ce mouvement-là, en diffusant autant que possible tous ces parcours de vie. <∫>
Inscrivez-vous pour lire l’intégralité du Magazine au format numérique
ou abonnez-vous pour le recevoir chez vous au format papier.