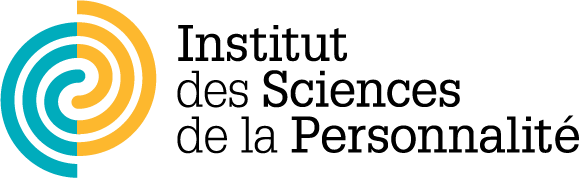Publié le
Kamel Bensaha dirige un ITEP – Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique – accueillant des jeunes en grande difficulté d’apprentissage, et qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire ordinaire.
Il nous raconte son parcours personnel, et les multiples facettes de son engagement au quotidien auprès de ces jeunes laissés en marge.
Interview réalisée par Marie-Noëlle Borel
“C’est un vrai enjeu de société, dans un environnement de plus en plus normatif, que de démontrer que l’on peut se développer positivement en dehors des routes classiques”
Kamel, commençons si tu veux bien par mieux comprendre ton métier : qu’est-ce qu’un ITEP ?
Un ITEP est un Institut thérapeutique, éducatif et social. Il a été créé suite au décret 2007 après la fin des Instituts de Rééducation.
Ce sont des jeunes qui ont des troubles d’apprentissages dont les origines peuvent être assez diverses et protéiformes… Ils relèvent du champ du handicap dans le sens où ne pas pouvoir apprendre dans les écoles du milieu ordinaire constitue un réel handicap à l’insertion sociale et professionnelle. Il est plus difficile de les caractériser par des troubles psychopathologiques, même si le décret l’évoque, de mon point de vue.
Je les considère avant tout comme des élèves qui ne peuvent pas “s’élever” dans le milieu ordinaire, et qui nécessitent que l’on en prenne soin, avant de leur dispenser des soins pour que leurs potentialités et leurs ressources puissent s’exprimer.
C’est un vrai enjeu de société, dans un environnement de plus en plus normatif : démontrer que l’on peut se développer positivement en dehors des routes classiques, en empruntant des sentiers de traverse !
Ce dispositif devrait s’agencer en milieu ordinaire, afin que nos institutions spécialisées puissent symboliser un camp de base. Ainsi, ces jeunes chemineraient d’un côté ou de l’autre de la frontière, qu’on espère de plus en plus poreuse, entre enseignement spécialisé et ordinaire.
De plus, l’expertise et l’expérience cumulées par nos praticiens devraient profiter aux collègues du milieu ordinaire et inversement. Notre dispositif a donc aussi vocation à être un centre ressource pour les familles, jeunes, partenaires de l’Éducation Nationale, l’Aide Sociale à l’Enfance, la Protection Judiciaire de la Jeunesse ,et plus largement tous les acteurs de notre secteur social. J’aime à penser que le secteur social se rapprochera du secteur des entreprises également pour réduire l’entre-soi, ou le huis-clos.
Nous répondions autrefois à un besoin sociétal de ne pas voir ces jeunes qui gênaient, de les invisibiliser. Aujourd’hui, on serait plutôt dans la perspective de ramener l’attention et la conscience collective sur ces jeunes, et leurs problématiques. Il s’agit également de les insérer même si le terme me dérange…
A mes yeux, ces jeunes sont comme des loupes, ils grossissent – par une forme d’hypersensibilité – certaines conséquences de nos choix de société. Peut-être que ces personnes, en marge, nous racontent une histoire intéressante sur notre société et sur nous-mêmes ? Et j’en viens même parfois à me demander si le fait d’être parfaitement inséré socialement ne constitue pas en soi une forme d’aliénation au regard de certaines valeurs humanistes…
“De l’invisibilité à l’insertion”
Peux-tu nous en dire davantage sur ton parcours personnel ? Comment es-tu arrivé à choisir cette voie, et cet engagement ?
On peut dire que pour des raisons personnelles, j’ai été, très jeune, un usager du secteur social. Je dois beaucoup au secteur de la Protection de l’Enfance, à l’École et aux belles personnes que j’ai rencontrées au cours de mon parcours.
Le regard des autres sur soi est important… Pour moi il a été déterminant. Entre la perversité, qui serait la négation de l’Autre, pour faire simple, et la névrose qui serait exister à travers le regard de l’Autre, j’ai choisi d’être névrotique (rires) !
Mon parcours scolaire est assez linéaire, car l’École constituait pour moi un refuge, mon refuge. Facile donc d’être un bon élève avec un comportement atypique.
J’ai été longtemps dans une ZUS du XIXe arrondissement de Paris, rue de l’Ourcq. A 17 ans, je crée avec deux amis d’enfance une association ENTR’AIDE pour fluidifier et pacifier les relations entre habitants d’un quartier. Quel plaisir que de se “ren-contrer” au sens de Derrida, de trouver chez autrui des ressources, de tordre le cou à nos préjugés…
J’ai poursuivi mon travail associatif parallèlement à mes études, j’ai fait de l’animation dans le XVIIIème pour financer mes études et apprendre à “gérer le conflit”, organiser des animations, repérer des potentialités… J’ai contribué à créer Espoir 18.
Ensuite je suis devenu prof de Sciences Économiques et Sociales et Mathématiques, chargé de TD à Panthéon-Sorbonne. J’avais l’impression d’une forme de schizophrénie, une identité dans le quartier avec les amis d’enfance ou dans les associations, une autre en classe en tant que professeur, formateur ou chargé de TD…
En réalité, il s’agit juste de forme, de langage, mais les compétences à développer sont les mêmes.
Je me suis longtemps considéré comme un passeur entre des mondes, traducteur d’une certaine manière !
Lorsque j’ai pu reprendre une formation, après avoir quitté la région parisienne, je me suis dit que si je pouvais faire un métier de mon engagement associatif, je réunirais enfin les deux Kamel !
C’est ce que j’ai fait il y a un peu plus de 4 ans. Démission de l’Éducation Nationale, veilleur de nuit pour financer mon Master 2 Direction des Organisations éducatives – où je suis intervenant aujourd’hui depuis 2 ans -, stage à l’ITEP Élise Rivet, Chargé de mission, Chef de service, Directeur Adjoint, tout cela dans l’association Prado Rhône Alpes, organisation à laquelle je reste très attaché.
Et aujourd’hui, depuis le mois de juillet 2018, Directeur du DITEP Isère avec l’association Union Commun.
“L’action sociale est-elle vraiment mesurable ?”
A quoi ressemble ton quotidien de directeur d’établissement ?
Il y a une part incompressible de gestion administrative dans ce métier, qui reste toujours un peu trop importante à mon goût.
Mais il y a beaucoup d’autres sujets sur lesquels le directeur d’établissement a un rôle essentiel à jouer : d’abord rencontrer les jeunes et leurs familles (nous accueillons une centaine de jeunes sur 3 établissements), les professionnels qui constituent mon équipe (40 personnes environ), et bien sûr établir et renforcer des liens de partenariat avec les acteurs locaux et territoriaux.
Tout ça demande du temps, et une patience… infinie !
Quelles ont les difficultés d’un tel engagement ?
J’en vois surtout deux.
La première est plus une tension qu’une difficulté, c’est une forme d’injonction paradoxale entre le discours de plus en plus orienté «résultats, indicateurs, budget, évaluation…» des financeurs et de l’État, d’une part, et la réalité de l’action sociale au quotidien d’autre part, beaucoup plus cyclique que linéaire. Un processus qui se décrit, mais qui va souvent échapper à la mesure.
Au-delà de l’horizon temporel qui est différent, on doit démontrer par des éléments «objectifs» la «valeur ajoutée» de nos actions. Ce qui devient une forme de communication, voire de marketing vis-à-vis des financeurs et donateurs, qui veulent «en avoir pour leur argent».
C’est un débat philosophique – entre deux conceptions du monde – qui agite régulièrement notre secteur…
L’autre point potentiel de lassitude, qui est probablement plus lié à mon histoire personnelle, c’est de parfois devoir se battre avec nos propres équipes pour monter et défendre des projets.
Moi je viens du bénévolat, et j’ai pu être – naïvement – très étonné de réaliser que l’état d’esprit d’un salarié n’était pas forcément celui du bénévole ! Il y avait sûrement une forme d’idéalisation de ma part, je plaide coupable (rires).
Quelles en sont les gratifications ?
Les jeunes, et leurs réussites, évidemment… Ce qui me touche le plus, c’est quand je suis surpris par ce qu’ils décident de faire, par ce qu’ils réussissent, par des ressources qu’on n’avait pas soupçonnées chez eux.
Ce n’est pas un métier où il faut s’attendre à des remerciements. C’est très compliqué d’être aidé quand on est en difficulté, d’accepter et de recevoir cette aide ! Alors quand ces jeunes reprennent le pouvoir d’agir et de décider de leur vie, et que dans certains cas, ils vont eux-mêmes aider des personnes âgées, ou monter des maraudes auprès des SDF, pour moi ça démontre tout l’essence de l’humanité : tu peux être vulnérable, aider et être aidé à tour de rôle.
Sur quelles ressources personnelles t’appuies-tu pour mener cette action au quotidien, et maintenir ce degré d’engagement ?
Je pense que le petit Kamel est souvent à mes côtés, tous les jours… j’ai la chance d’avoir une épouse qui travaille également dans ce secteur médico-social, et nous discutons souvent de nos métiers avec nos 4 filles.
J’essaie de rester très vigilant sur les risques de syndrome du sauveur, où tu peux perdre le contact avec la réalité en idéalisant ton action vis-à-vis des regards extérieurs, par exemple. La famille reste ton meilleur marqueur pour vérifier ton niveau d’humilité et d’authenticité, et j’ai vraiment cette chance-là.
En termes de philosophie ou de spiritualité, je me réclame surtout de valeurs humanistes : je crois en l’être humain, tout simplement. Et je vérifie régulièrement l’alignement de ces valeurs avec mon action, et le cadre dans lequel elle se déroule.
On ne peut pas maintenir un degré d’engagement maximal tout le temps, mais nos métiers sont d’abord des vocations et des choix de vie, donc si les valeurs personnelles sont bafouées, ce n’est pas tenable.
Qu’est-ce que tu aimerais transmettre à ceux/celles qui envisageraient de s’engager eux/elles aussi au service des autres aujourd’hui ?
Venir vite s’éprouver face à la réalité ! Commencer par du bénévolat, sur un public ou un contexte pour lequel on a de l’appétence. Et garder un autre projet professionnel à côté, au cas où…
Notre secteur a encore plein de choses à construire en termes d’innovation sociale et d’inventivité, c’est un formidable terrain d’expression et de potentialités, pour des jeunes ou des moins jeunes. <∫>